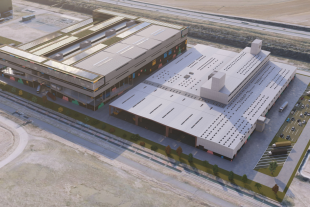La justice européenne fait-elle de la politique quand elle se prononce sur des sujets comme le CETA, les réfugiés, la fiscalité ou la politique monétaire? François Biltgen, le juge luxembourgeois à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ne le pense pas et explique en quoi l’institution est parfaitement dans son rôle.
L’Union européenne traverse une série de graves crises. La défiance grandit. Comment cette situation est-elle vécue à la CJUE?
François Biltgen : La Cour existe depuis plus de soixante ans et elle en a vu d’autres. Elle a toujours été un phare dans la tempête. En 1977, quand je faisais ma première année de droit au centre universitaire de Luxembourg, l’UE était en pleine « eurosclérose » comme on disait alors : plus rien ne fonctionnait sauf la Cour de justice. Aujourd’hui, au contraire, la volonté politique est là. L’UE a toujours traversé des crises et c’est bien d’avoir une Cour qui joue ce rôle de phare.
Ce qui signifie?
Le phare est bien fixé au sol pour résister aux tempêtes et, en même temps, il offre une vue au-delà de la tempête. À la Cour, nous sommes confrontés à des réalités concrètes, toutes nos affaires sont casuistiques. Dans le même temps, nous sommes fermement ancrés dans le droit européen. Une des particularités de l’Union est qu’elle n’est pas un État de droit, mais qu’elle fonctionne comme tel. J’aime beaucoup l’expression anglaise rule of law qui dit qu’il faut des textes qu’on applique et qu’il faut un juge indépendant et impartial qui interprète uniformément ces textes.
Dans l’arrêt rendu en septembre rejetant les recours de la Hongrie et de la Slovaquie contre les quotas de réfugiés, Budapest a mis l’impartialité de la Cour en doute, qualifiant la décision de « politique »…
Nous devons donner tout son sens au texte que nous interprétons, tout en nous y tenant. L’UE n’est compétente que pour ce que les États membres lui attribuent. La Cour est liée par cela. Dans ce cas précis, la décision du Conseil d’établir des quotas pour répartir les réfugiés entre États membres était légale. Si on regarde le temps que nous avons pris et la procédure mise en œuvre, nous nous sommes donné beaucoup de peine pour déblayer les arguments de droit avant d’arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision du Conseil. Cela dit, il y a une balance à faire entre les principes du droit de l’UE, qui priment sur le droit national, d’une part, et les marges d’appréciation des autorités nationales, d’autre part. Nous devons jouer ce rôle sans jamais flancher.
Depuis un an, la Cour est saisie de sujets fondamentaux tels que les tribunaux arbitraux dans les accords de libre-échange, le rachat de dettes souveraines par la BCE, la fiscalité des multinationales ou les quotas de réfugiés. Les réponses à ces questions ne sont-elles pas plutôt politiques que juridiques?
La Cour n’a jamais été autant sollicitée quantitativement et elle l’est aujourd’hui sur des sujets très importants. Je vois deux raisons à cela. La première est que l’Union a de plus en plus de compétences. Si l’on revient à nouveau quarante ans en arrière, son champ de compétences était réduit à celui d’une Communauté économique. Aujourd’hui, l’UE a énormément plus de compétences et elle met en œuvre des politiques complexes. Il est donc normal que nous soyons davantage sollicités.
Et la deuxième raison?
C’est la question du processus démocratique gouverné par la transparence, le contrôle et la participation. Il faut aussi un pilier juridique avec un droit qui doit être clair et appliqué uniformément. Il y a eu un grand effort de démocratisation de l’UE, notamment avec la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire la coopération entre le Parlement européen et le Conseil. Mais il y a des domaines où le contrôle démocratique du Parlement n’existe pas, comme les matières bancaires et financières. Pour cela, il y a la Cour et c’est pourquoi elle est saisie de questions telles que le rachat des dettes.
On peut avoir le sentiment que le politique demande à la CJUE de prendre des décisions qu’il ne veut ou ne peut pas prendre par manque de courage politique ou en raison de blocages institutionnels?
Je vois qu’il y a des décisions qui sont contestées devant notre Cour. Dans l’affaire des quotas de réfugiés, le Conseil avait pris ses responsabilités en décidant à la majorité, comme le lui permettent les textes, sans chercher le consensus. Dans ce cas, l’on ne peut pas reprocher au Conseil de ne pas avoir pris de décision et il est important d’en prendre, même s’il y a divergence de vues. En dernier lieu, il faut cependant savoir se soumettre à une appréciation juridique.
Soumettre ces recours à la Cour n’est donc pas trop lui demander?
Non, on demande à la Cour de faire son travail… Ma grand-mère me dirait : « Tu es payé pour ça. » On demande à la Cour de tenir son rôle et je crois que c’est une bonne chose, même s’il y a toujours des critiques. Mais son existence n’est plus remise en cause comme cela a pu être le cas par le passé. Plus personne aujourd’hui ne conteste son bien-fondé, sauf celui qui veut quitter l’UE… notamment parce qu’il y a une Cour.
Il y a des domaines où le contrôle démocratique du Parlement européen n’existe pas, comme les matières bancaires et financières
À vous entendre, la marge de manœuvre de la Cour reste réduite?
Nous ne jugeons pas le détail d’une politique. Nous jugeons si la compétence exercée par une institution est en conformité avec le droit. Si l’Union ne dispose pas d’une compétence, nous ne sommes pas là pour jouer au législateur. On peut demander trop à la Cour, mais elle ne peut donner que ce qu’elle a le droit de donner. Cela dit, dans les années 70, elle faisait avancer le droit. Pierre Pescatore, qui fut mon professeur et qui fut juge à la CJUE, ne s’en défendait jamais… Plus tard, il a même reproché à la Cour de ne plus être aussi téméraire. Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas maîtres de notre agenda. C’est une des grandes différences avec la Cour suprême aux États-Unis. Nous devons répondre à tous les recours qui nous sont soumis. La Cour suprême américaine est plus créatrice, elle peut se saisir d’un sujet qui lui semble plus important. Ce n’est pas notre cas.
Vous devez répondre à toutes les questions, y compris à celles qui touchent au quotidien très concret des Européens…
On parle beaucoup des grands arrêts retentissants, alors que nous prenons tous les jours de petits arrêts, si j’ose dire. Ils concernent les citoyens dans leur vie courante. Un bon exemple, ce sont les arrêts Kohll et Decker, dont on va fêter les 20 ans en avril. Dans ces affaires luxembourgeoises, la Cour devait dire si la sécurité sociale luxembourgeoise devait ou non rembourser des soins dentaires dispensés à Trèves et des lunettes achetées en Belgique. Cela posait la question des libertés fondamentales introduites il y a plus de soixante ans par le traité de Rome : libre circulation des travailleurs, des capitaux, des marchandises et des services. Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il y avait entraves à la libre circulation des marchandises et des services et qu’elles n’étaient pas justifiées, car ce ne sont pas des lunettes et un traitement dentaire qui vont couler la sécurité sociale luxembourgeoise. Dans ce recours, beaucoup d’États avaient soutenu le Luxembourg. Depuis 2011, une directive codifie cette jurisprudence qui dit aux malades dans quelle mesure ils peuvent être soignés dans un autre État membre. Dans de petites affaires très concrètes comme celle-ci – et j’en reviens à l’ancrage dans la réalité –, nous prenons des décisions qui obligent tous les États membres à s’y conformer.
La Cour prend donc toute sa place dans l’équilibre institutionnel et aurait peut-être même tendance aujourd’hui à s’affirmer face à la Commission et au Parlement?
Le traité de Lisbonne a formidablement accru les compétences de l’Union. Or il faut quelquefois déterminer quels sont les pouvoirs des uns et des autres, à qui revient l’initiative. Nous sommes saisis de sujets sur lesquels tout le monde est d’accord sur le fond, mais pas sur la procédure. En 2014, nous avons ainsi été saisis de la question de l’échange d’informations transfrontalières en matière d’infractions routières. Dans ce recours, la Cour devait donner son point de vue sur la base juridique correcte, ce qui implique aussi l’équilibre institutionnel. Avec le traité de Lisbonne qui n’a pas encore dix ans, ce sont parfois ces arrêts qui aident les institutions à trouver leur place, à savoir quel rôle doivent jouer la Commission, le Conseil, le Parlement européen et les États membres.
En mai, la Cour a considéré que le traité commercial signé entre Singapour et l’UE ne peut pas être conclu par l’UE seule, car certaines dispositions envisagées relèvent de la compétence partagée entre l’UE et les États membres. Pour les opposants à ces accords, cet avis constitue un « désaveu » de la Commission. Est-ce le cas?
Non. Dans l’avis Singapour, nous avons précisément dit quelle est la place de chacun. On s’est limité à déterminer s’il y a compétence exclusive de l’UE, compétence exclusive des États membres ou compétence partagée. La saisine de la Commission portait uniquement sur ce point et non sur le fond. Nous avons rendu cet arrêt en plénière, à 28 juges donc, afin que l’Union et les États membres sachent chacun quel est son rôle dans la conclusion des prochains accords commerciaux. À l’avenir, cela facilitera la négociation de ces accords.
Le fond de l’affaire, ce sont les tribunaux arbitraux qui suscitent une vive opposition, y compris parmi les magistrats, en Allemagne notamment.
Nous venons seulement d’être saisis par la Belgique dans le cadre du CETA et je n’en parlerai donc pas. Un accord commercial doit autoriser un investisseur à aller dans un autre État. Soit chaque ensemble juridique reste compétent, ce qui veut dire qu’un investisseur qui vient en Europe sera soumis aux tribunaux compétents en Europe et inversement pour l’investisseur européen qui va dans un autre État. Soit on crée un tribunal arbitral. L’idée est de donner une certaine sécurité juridique aux investisseurs des deux côtés. La question qui se posera à nous est de savoir si la solution trouvée est conforme au droit de l’UE.
En quittant la politique en 2013, vous avez dit que vous alliez réaliser un rêve en devenant juge à la CJUE. La réalité est-elle à la hauteur du rêve?
C’est ce à quoi je m’attendais. Toutes mes études étaient concentrées sur le droit de l’Union, alors appelé droit communautaire. Comme député, j’étais souvent rapporteur de directives à transposer. En tant que ministre, je devais également en transposer et j’ai négocié des directives. J’ai étudié, appliqué, transposé, commenté et négocié le droit de l’Union. Maintenant, je l’interprète.
Nous ne sommes donc pas près de vous revoir en politique…
Non. Et je ne vais pas non plus commenter à tout bout de champ l’actualité. D’une part, je n’en ai pas le droit vu mon statut. Et, d’autre part, je me suis juré à l’époque de ne jamais jouer à ces « anciennes gloires » qui ont une opinion sur tous les sujets.
Entretien réalisé par Fabien Grasser
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois