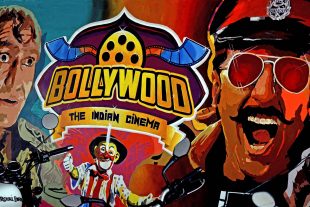The Last of Us fait mentir la tradition qui dit qu’adapter un jeu vidéo à l’écran est généralement catastrophique. La série démontre même que le genre post-apocalyptique a encore des choses à dire, quand on le manipule avec humanité.
On ne compte plus aujourd’hui les échecs, faillites et autres ratages des adaptations de jeux vidéo à l’écran (pour le petit comme le grand). Ils sont trop nombreux, mais s’il fallait en dresser une liste, elle serait dominée par le réalisateur allemand Uwe Boll, massacreur en chef. Mais ne lui jetons pas la pierre, car d’autres, avant et après lui, connaissent le même problème : celui de rester coincé entre deux univers, filmique et ludique, sans que l’un ou l’autre n’y gagne au change.
Sortie le 15 janvier sur la chaîne HBO et achevée ce dimanche au rythme d’un épisode par semaine, la série The Last of Us fait mentir cette triste tradition pour devenir, aux yeux de beaucoup, la meilleure transposition de tous les temps, chiffres à l’appui : en 2013, le jeu de Naughty Dog s’était vendu à plus de 37 millions d’exemplaires dans le monde. Le neuvième et dernier épisode, lui, a été regardé par 8,2 millions de spectateurs outre-Atlantique.
Ce n’est pourtant pas la première saga du genre post-apocalyptique à connaître une seconde vie, à l’instar de Resident Evil (2002- 2016), pour ne citer que la plus célèbre d’entre elles. Mais The Last of Us a été malin sur un point : embaucher pour la série l’un de ses créateurs originaux, Neil Druckmann, qui confiait justement début janvier au New York Times : «Le plus important était de garder l’âme» du jeu, et pas forcément des séquences (cinématiques) entières.
«Ce qui fait cette série, ce sont les personnages et leurs questions philosophiques telles que « la fin justifie-t-elle les moyens? » ou « de quelle taille est la tribu dont vous devez vous occuper ? »», ajoute-t-il. Une philosophie suivie à la lettre, et peaufinée par le scénariste Craig Mazin, récompensé pour Chernobyl. On a donc là un duo focalisé sur un autre : Joel et Ellie, les deux héros de l’histoire, qui vont prendre toute la place, du début à la fin.
Deux anciens de Game of Thrones qui se retrouvent
On résume pour les non-gameurs : on est en 2003, à Jakarta, en Indonésie, ville à l’origine d’une pandémie mondiale. La raison? Ni un virus ni une bactérie, mais un vulgaire champignon (le cordyceps) qui prend possession des êtres humains et les transforme en zombies. Au milieu du chaos rapidement planétaire, on trouve Joel, brisé par la mort de sa fille et la disparition de son frère.
Vingt ans plus tard, dans un monde en ruine, il part à la recherche de ce dernier, dont il a perdu le contact. Soit un trek de 4 000 kilomètres à travers les États-Unis (de Boston à Salt Lake City) avec, sur les bras, Ellie, adolescente orpheline immunisée contre l’infection, qu’il doit protéger, car elle serait le dernier espoir de l’humanité. Mais la balade est risquée : dehors, les montres rôdent. À moins que le véritable ennemi ne soit l’homme lui-même, des survivants hostiles aux membres de la FEDRA (sorte de dictature militaire) et ses opposants-mercenaires (les Lucioles).
The Last of Us, version HBO, aurait pu facilement tomber dans des travers déjà observés précédemment : sortir les flingues et jouer des poings pour mieux gommer l’absence de scénario. Il n’en est rien, bien au contraire ! La série préfère en effet la douce déambulation à l’action, la réflexion à l’horreur et à la violence, geste rare au vu des récentes productions de plus en plus musclées et décérébrées.
Pour ce faire, elle multiplie les bonnes idées : miser sur un tournage grandeur nature (au cœur du Canada) et privilégier l’alternance dans la réalisation, avec, entre autres, Jeremy Webb (Downton Abbey), Jasmila Žbanić (Ours d’or en 2006 pour Grbavica) et l’Iranien Ali Abbasi (le récent Holy Spider). Un casting de qualité, et sans star, qui s’observe aussi devant la caméra, notamment à travers ses deux figures principales : Pedro Pascal, le policier de choc – et à moustache! – de la série Narcos, qui retrouve ici la jeune actrice Bella Ramsey, les deux ayant joué dans Game of Thrones (dans les rôles d’Oberyn Martell et Lyanna Mormont).
Les zombies mis de côté, pour mieux célébrer la vie
Au sein de villes «charniers» décrépites, de forêts enneigées ou de ces «ZQ» (zones de quarantaine) avec leurs couvre-feux et leurs décisions arbitrales – toute ressemblance avec une récente crise sanitaire est fortuite –, la série colle au plus près les deux personnages en perdition dans un monde qui n’en est plus vraiment un. En ce sens, cette adaptation approfondit la tradition dystopique du jeu, tout en restant fidèle à son noyau émotionnel.
C’est un fait, mais The Last of Us ressemble moins à une énième réalisation sur les morts-vivants ou de la veine survivaliste (genre Walking Dead) qu’à une version de La Route de Cormac McCarthy. Avec, pour le coup, un «homme» et une «petite» : le premier, sombre et déprimé, a besoin d’une fille (de substitution) et la seconde, effrontée et spontanée, d’un père. Au gré de leur pénible traversée, chacun va apprendre de l’autre. Osons donc parler d’œuvre d’apprentissage.
The Last of Us ne fait donc pas peur (ou si peu) et met clairement de côté les zombies (les «infectés») pour célébrer la vie, dans tout ce qu’elle a de plus nécessaire quand une civilisation bascule dans le chaos et tente de se reconstruire. À la loupe, et sans se presser, la série ausculte ainsi l’intime complexité de l’être humain poussé dans ses derniers retranchements, mais déterminé à survivre, quoi qu’il en coûte.
On y évoque, comme dans n’importe quel récit post-apocalyptique, le retour à l’animalité, la mort, la joie et la tristesse, la solitude et la mélancolie, le bien et le mal… Mais ici, c’est l’amour qui tient une place centrale, comme l’expliquait Craig Mazin : «Il est derrière les choix et les comportements les plus extrêmes que l’on fait (…) Les parents disent souvent à leurs enfants : « Je t’aime plus que tout au monde ». Est-ce que c’est vraiment le cas ?» Quand on connaît la décision que prend Joel à la toute fin de l’histoire, il n’y a aucune raison d’en douter…
Sonic, Grand Turismo, Super Mario et les autres
La série, par l’intermédiaire d’allers-retours entre passé et présent, insiste aussi sur les liens qui unissent ses personnages secondaires : l’attachement indéfectible entre deux frères, la passion entre deux hommes (le très réussi troisième épisode avec Bill et Frank) ou au cœur d’un vieux couple… Dans le même sens, elle raconte qu’une société ne peut perdurer sans un maximum de bienveillance et d’écoute entre ses membres (à l’image, il est certain qu’il est préférable de vivre dans une communauté démocratique et participative que dans d’autres, religieuses ou militaires).
Et si dans ce cauchemar, le vrai monstre, c’est toujours l’humain (un principe convenu), The Last of Us cherche à l’expliquer, au détriment des scènes de combat ou de découvertes horrifiques. Sans pour autant manquer de tension dramatique ou de suspense.
Bien sûr, Neil Druckmann et Craig Mazin peuvent encore faire mieux. Les fans sont toujours exigeants, et il est vrai qu’en creusant, certains choix questionnent : pourquoi, alors que c’est le cas dans le jeu, ne pas avoir permis la transmission des germes par l’air (et ainsi ressortir les masques) ? Et pourquoi, sur leur chemin, Joel et Ellie sont si souvent seuls? Où sont les animaux et les hommes (morts ou vivants) ? Gageons qu’ils sauront y répondre dans une seconde saison, déjà prévue par HBO, qui tient sûrement là son nouveau blockbuster, sachant que pour de nombreux joueurs, le deuxième volet surpasse le premier en termes d’émotions. En attendant les retrouvailles, il y aura toujours moyen d’aller voir le troisième Sonic, la série animée Tomb Raider (sur Netflix), la première mouture au cinéma de Gran Turismo ou encore Super Mario et Donjons et Dragons, prévus ces prochains jours. Pas sûr, toutefois, que l’on y survive.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois