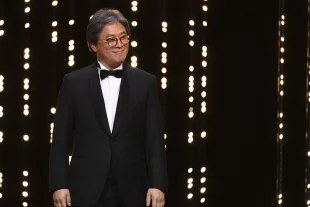Comédienne devenue poète, Fadwa Souleimane était le porte-voix pacifique de la contestation à Homs, en Syrie, lors de la révolution. Exilée en France, elle raconte sa souffrance et ses espoirs. Entretien exclusif.
Invitée du 9e Printemps des poètes – Luxembourg, en fin de semaine prochaine, elle viendra y présenter son livre À la pleine lune et parler avec le public de son expérience personnelle sur le conflit syrien.
Qui suis-je encore quand mon visage, mon nom, la fleur de ma jeunesse, ma langue, ma voix, ma mémoire, sont restés là-bas habillés des débris de mon pays ?»… Voilà une phrase tirée de son recueil de poésie, À la pleine lune (éditions Le Soupirail, traduit de l’arabe par Nabil El Azan), qui symbolise bien l’écriture «nécessaire» de Fadwa Souleimane. C’est en effet de l’intérieur qu’elle tente de mettre des mots sur l’expérience profonde qu’elle a du conflit syrien. Ses populations divisées. Ses quartiers explosés. Sa parole étouffée. Et, bien sûr, son exil forcé depuis 2012…
Comédienne, militante pacifiste, figure marquante de la contestation à Homs, au point d’être présentée dans certains médias comme une icône, Fadwa Souleimane a dû quitter en 2012 son pays, sous la pression des forces de sécurité de Bachar al-Assad, pour partager cette fois le sort des exilés. Réfugiée politique à Paris, elle a écrit pour le théâtre un texte, Le Passage (déjà présenté à Avignon). Les poèmes d’À la pleine lune constituent donc sa seconde expérience littéraire disponible en français.
Un recueil qui «nous mène aux territoires de nos mémoires dans un chant de colère, la colère de la terre meurtrie, la colère du sens assassiné, et d’une attente tachée par la barbarie des hommes. Le poème, retranscrit dans sa musicalité et dans le flux et reflux des mots, impose la beauté de la langue, libre, en réponse au chaos»… C’est de Paris que Fadwa Souleimane s’est confié au Quotidien.
Vous avez d’abord été actrice et comédienne. L’écriture a-t-elle toujours été présente chez vous ?
Fadwa Souleimane : J’ai commencé l’écriture en France, pas en Syrie. C’est vrai, durant certaines périodes de ma vie, j’ai été tenté par l’écriture, mais sans jamais franchir le pas. Au début de la révolution, en 2011, je m’y suis mise, à travers quelques modestes poèmes. À ce moment-là, j’ai découvert que je pouvais, à travers les mots, sortir quelque chose de moi. Mais c’est seulement après mon départ que ce sentiment s’est clairement développé.
Pourquoi ?
Après des années de dictature, le peuple syrien a retrouvé sa voix par l’action, durant la révolution, alors qu’elle était, pour ainsi dire, morte depuis longtemps. C’était un rêve! Mais paradoxalement, j’ai dû vite partir. En France, je me suis alors retrouvée hors de moi-même, sans visage, sans identité. Il fallait alors que je retrouve ma langue, que j’y retourne pour renouer avec mon pays. Et c’est donc arrivé par l’écriture.
Votre écriture est-elle donc à voir comme une nécessité ?
Tout à fait. J’avais tout perdu : mon pays, mes racines, mon combat, ma voix… J’ai alors recherché la Syrie par les mots, tout en cherchant à partager mes connaissances avec mon pays d’accueil. Lui faire connaître notre littérature, notre imagination, nos souffrances aussi.
Écrire pour exister, donc.
Écrire pour continuer à vivre, surtout.
Voyez-vous également l’écriture comme un acte de résistance ?
Dans un sens, n’importe quelle sorte d’écriture est un acte de résistance. C’est à travers elle qu’on défend des idées, des pensées, une vision du monde et la manière dont on rêve de l’améliorer.
Comment vivez-vous votre condition d’exilée depuis 2012 ?
Au début, c’était très dur. Jamais, de toute ma vie, je n’avais imaginé que je pouvais vivre en dehors de la Syrie. Pourtant, à un moment, au plus fort de la révolution, j’étais devenue une étrangère, une exilée dans mon propre pays. Malgré tout, ça restait ma Syrie, ma terre, mon ciel et mon soleil. Et elle avait besoin de moi! Même quand la situation est devenue très compliquée à gérer…
Vous avez dû alors vous enfuir, à contrecœur…
J’étais très mal, très triste. Surtout quand on s’intéresse aux origines de cet exil. J’ai été interdite dans mon propre pays, parce qu’avec d’autres, on a demandé la liberté, la justice de manière pacifique. On a été chassés parce qu’on a tendu des rameaux d’olivier face aux armes. Pour avoir réclamé notre liberté d’expression, de construire notre pays, de partager, de mener notre vie comme bon nous semblait. Une fois en France, j’ai eu le sentiment d’être étrangère à moi-même. Il était plus que nécessaire de transformer cette émotion en création. Il fallait revenir vers la vie. Dans un sens, cet exil a révélé des choses enfouies en moi, m’a bonifiée.
Que vous évoque la situation actuelle en Syrie ?
J’ai le sentiment, depuis toujours, que le régime syrien est un petit employé d’un système mondial qui vole nos richesses et nous interdit d’accéder à la démocratie, d’échanger d’égal à égal. Une sorte de colonisation perverse pour que l’on n’arrive à rien. C’est une honte! Que dire des amalgames qui ont été faits lors de la révolution, où de nombreux médias dans le monde nous ont comparés aux extrémistes religieux, alors que l’on est pacifistes! Aujourd’hui, la communauté internationale, sous couvert de vouloir combattre le terrorisme, bombarde le pays. À mes yeux, elle ne fait, par ce choix, que renforcer la conviction des extrémistes. Entre les gens qui tuent au nom de Dieu ou d’un régime politique et ceux qui usent de balles, de gaz mortels et de bombes, il n’y a pas une grande différence… La violence génère la violence. J’ai eu peur dès que la révolution a commencé. Je ne suis guère plus rassurée.
Avez-vous un peu d’espoir ?
J’ai une conviction : le peuple syrien est et restera fort face à Daesh, face à Bachar al-Assad, face à l’intervention internationale. Et puis, la Syrie ne date pas d’hier. Notre histoire et notre culture remontent à des siècles, bien longtemps avant que ces balles ne sifflent…
Vous venez au Luxembourg la semaine prochaine pour notamment votre ouvrage À la pleine lune. Pouvez-vous nous le présenter, nous le raconter ?
(Elle souffle) C’est difficile à dire. Disons que c’est le long chant d’un peuple. De douleur, de violence, d’absurdité, de colère. Un questionnement aussi sur l’humanité et son héritage, depuis Caïn et Abel, et cette barbarie, cette haine inhérente. C’est enfin un cri, entre passé et futur. Un cri qui m’a réveillée.
Vous parlez d’héritage et, justement, depuis 2012, vous intervenez de manière régulière dans les écoles, les lycées, les universités. Cette transmission est-elle essentielle ?
Bien sûr. À la pleine lune, d’une certaine manière, m’a fait découvrir la France. Et ces rencontres avec des étudiants, intellectuels, journalistes, poètes, enfants… ont été très riches pour moi. Une page blanche s’est remplie. Alors oui, transmettre ses vérités et son expérience sur la Syrie, l’Orient, c’est quelque chose d’essentiel. Mais recevoir l’est tout autant.
Entretien réalisé par Grégory Cimatti
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois