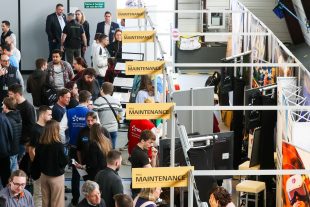Cette semaine, on écoute Gadzooks Vol. 1 de Caleb Landry Jones, sorti sur le label Sacred Bones Records le 24 septembre. Critique.
Caleb Landry Jones aime le jeu. Sous de multiples formes. Devant la caméra, quand il incarne au plus près ses personnages. Au cœur du studio, aussi, où il se laisse aller à l’expérimentation sans entrave. Même les pochettes de ses albums témoignent de son appétence pour la métamorphose : le teint blanc et les lèvres rouges, poudré et perruqué tel un marquis fumant lascivement une cigarette sur The Mother Stone; grimaçant et comme habité par la folie, surmonté d’une chevelure de feu façon grunge à la Kurt Cobain sur Gadzooks.
Oui, il est à l’aise dans tous les rôles, ...
Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois