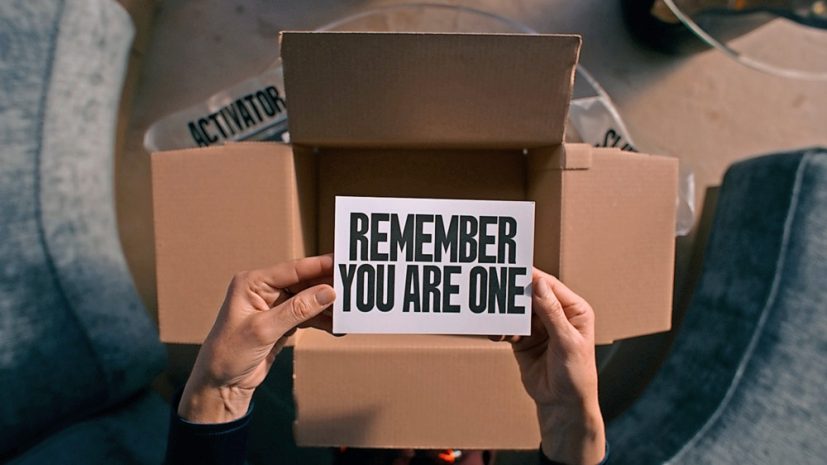The Substance
de Coralie Fargeat
Avec Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid…
Genre horreur
Durée 2 h 21
Depuis que Julia Ducournau, recevant sa Palme d’or pour Titane (2021), a remercié le jury de Spike Lee de «laisser entrer les monstres» (plus largement : les archétypes connotés d’un certain cinéma populaire) dans le petit monde de l’art et essai, la gentrification du cinéma dit «de genre» a passé la quatrième vitesse.
Dans cette affaire, personne n’est véritablement à blâmer. Ni les jeunes cinéastes en question, de leur propre aveu biberonnés au frisson et au gore, et dont la démarche artistique semble le plus souvent sincère, ni le festival de Cannes, qui fait l’effort de sélectionner de tels films si éloignés de ses canons, ni les sociétés de production qui ont trouvé dans la nouvelle vague horrifique «arty» et (souvent trompeusement) intello une nouvelle poule aux œufs d’or, capable à la fois de rivaliser avec les machines à fric déclinées ad nauseam sur leur propre terrain (chaque nouvel opus de Scream, The Conjuring, Saw et consorts est un carton assuré) et de se tailler une place dans les habitudes cinéphiles de publics pas forcément gourmands d’horreur.
Depuis l’invention du cinéma, le genre fantastique dans sa globalité a toujours été entravé dans sa double nécessité de lier profit commercial et ambition des grands discours politiques et sociétaux qui lui sont inhérents (voir George Romero, John Carpenter, Mario Bava…). Pour faire tomber ce mur une bonne fois pour toutes, il n’y a eu que l’embourgeoisement du genre.
Indépendamment de ses qualités (nombreuses) et de ses défauts (pardonnables), The Substance, deuxième film de la réalisatrice française Coralie Fargeat, en est autant le remède que le symptôme. Un film, on le sait, n’est jamais uniquement ce qu’il montre et raconte – et surtout pas ce que veut en assumer son auteur(e).
Celui-ci, qui montre et raconte beaucoup, sans s’embarrasser par ailleurs de subtilités, ne fait pas exception. Les deux plans fixes qui se succèdent en ouverture suffisent à le résumer : il y sera question de monstruosité (la «Substance», injectée dans un jaune d’œuf, en fait naître un second, identique) et de passage du temps, idée symbolisée par une étoile sur Hollywood Boulevard, depuis sa mise en place jusqu’aux dernières fissures qui lui font perdre son éclat d’antan.
La dalle étoilée est au nom d’Elizabeth Sparkle (Demi Moore), animatrice d’une émission d’aérobic jugée trop vieille pour poursuivre sa carrière, qui a recours au fameux sérum vert pour se dédoubler en une «meilleure version d’elle-même», jeune et physiquement «parfaite» – en accord avec les standards de la chaîne, commandée par une tripotée de vieux mâles blancs cisgenres, sûrement violeurs à leurs heures perdues.
Le pacte faustien entre la matrice et Sue (Margaret Qualley), son double amélioré, les injonctions à la beauté et à la jeunesse éternelles, le vieillissement comme principe premier de la peur, le ridicule des hommes puissants (un procédé comique qui se substitue au danger bien réel qu’ils inspirent – le producteur s’appelle Harvey)… Autant d’évidences qui visent à servir le propos de la cinéaste et sont rabâchées avec insistance, sinon avec lourdeur, entre overdose de gros plans sur des fesses et objectifs de caméra utilisés pour découper et déformer les silhouettes masculines.
Mais The Substance est, plus que toute autre chose, un film sur le corps féminin comme il en existe peu, ou pas, car c’est bel et bien au spectateur de dénicher et d’interpréter ici toutes les complexités dissimulées sous une surface outrancière.
Alors, plutôt que de jouer la comparaison avec David Cronenberg (incontestable), The Substance a plutôt à voir avec Barbie (Greta Gerwig, 2023), précisément parce qu’il en est le miroir inversé : les deux films, d’ailleurs, parodient 2001 : A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) quand il s’agit de présenter leur héroïne à leur plus majestueusement «difforme». Ironie du sort : c’est le jury de Greta Gerwig qui a récompensé, cette année à Cannes, le scénario de The Substance.
Outre la direction artistique, superbe de simplicité (deux codes esthétiques : la froideur clinique pour Elizabeth, le rose bonbon tendance «glitter» et hypersexualisé pour Sue), ce qui fait surtout du film une réussite, ce sont ses actrices.
À commencer par Demi Moore : le personnage d’Elizabeth tend clairement un miroir à son interprète, sex-symbol des années 1990, star de films aux titres racoleurs tels que Indecent Proposal (Adrian Lyne, 1993), Disclosure (Barry Levinson, 1994) ou Striptease (Andrew Bergman, 1996), et reléguée depuis une vingtaine d’années au second plan (on aura compris pourquoi). Chez Coralie Fargeat, son interprétation seule insuffle l’émotion et la finesse que le script n’a pas, par exemple dans une scène nerveuse et poignante de préparation à un rendez-vous galant.
D’un autre côté, l’actrice se donne aussi à fond dans l’exubérance crasse au détour d’une scène de cuisine cathartique, prélude à un final archisanglant qui évoque ceux de Carrie (Brian De Palma, 1976), de Society (Brian Yuzna, 1989) et, dans une moindre mesure, de Bad Luck Banging or Loony Porn (Radu Jude, 2021). Avec une différence notoire : les modèles que la cinéaste entend subvertir, évidemment conditionnés par ce même male gaze qu’elle pastiche joyeusement, sont aussi profondément antibourgeois.
Dans The Substance, la destruction du corps féminin est surtout un objet de spectacle. Même au cinéma, il faut un peu plus que quelques hectolitres de sang, aussi bienvenus soient-ils, pour malmener le confort de ce cinéma indépendant boboïsé. Plutôt que d’en tirer des leçons, on ne doute à aucun moment qu’il préférera capitaliser sur son succès.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois