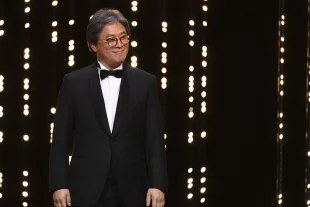Cette semaine, Petite fille, de Sébastien Lifshitz. Le plus beau morceau de cinéma que l’on pourra voir cette année.
C’est une œuvre délicate, qui tire du réel la poésie d’une histoire comme il en existe bien d’autres, invariablement contées sur le ton du drame. C’est un film important, qui se refuse à tous les écueils dans lesquels tombent – souvent parce qu'ils se soucient trop de les éviter – tous les autres récits cinématographiques qui prennent pour sujet l’identité trans. C’est l’histoire d’un combat noble, celui d’une petite fille qui veut s’affirmer mais à qui l’on s’oppose, ...
Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois