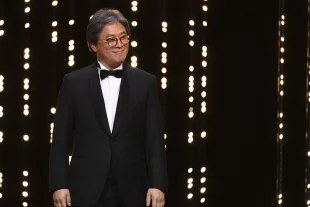Cette semaine, nous avons choisi de regarder : "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy De Palma…
Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois