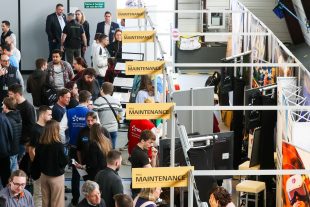David Fincher fait son retour au cinéma avec Mank, récit de l’écriture de Citizen Kane derrière lequel se cache un discours insolent et actuel sur les rouages de l’industrie hollywoodienne.
Au début du film, David Fincher fait dire à son protagoniste une prière, l’envie que Dieu lui envoie «un signe», après la désastreuse aventure The Wizard of Oz (1939), dont il fut le premier d’une armée de scénaristes et dont la seule contribution visible a été l’idée du passage du noir et blanc (le monde réel) à la couleur (le monde d’Oz), glorieux procédé cinématographique pour lequel Herman J. Mankiewicz n’a même pas eu les honneurs d’une mention au générique. Le signe divin lui apparaît alors que «Mank» est à l’hôpital, après avoir été victime d’un accident de voiture. Une silhouette épaisse, facilement reconnaissable, qui s’approche du blessé et lui envoie, de sa fameuse voix grave : «Mank ? It’s Orson Welles.» «Of course it’s you», répond celui qui ne sait s’empêcher de parler, peu surpris que le Tout-Puissant lui envoie le «petit génie de New York» comme preuve de son salut.
La paternité du scénario de Citizen Kane est un sujet sur lequel s’écharpent les historiens du cinéma depuis 80 ans, bataille entretenue par les ...
Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois