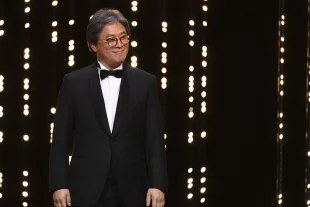Peninsula comptait se poser comme le digne successeur du réputé Dernier Train pour Busan, du même Sang-ho Yeon.
Il n’en est qu’un prolongement primitif, noyé sous la
testostérone, les pixels et les violons.
Face à des cinémas désespérément vides et des vagues de confinement qui n’arrangent rien à l’affaire, il est nécessaire, vital même, de sortir les arguments forts afin de faire revenir un public masqué et boudeur dans les salles. Pour le coup,
Peninsulay va sans retenue : d’abord avec cette prestigieuse estampille «Cannes 2020», le festival l’ayant retenu, avec quelque 55 autres films, au sein de son label exclusif, à défaut de mieux. Ensuite, par cette filiation évidente avec
Dernier Train pour Busan(et par ruissellement, avec le préquel d’animation
Seoul ...Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l'ensemble de ses articles, vous propose de découvrir ses offres d'abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois