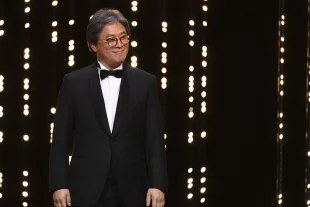Lundi 6 septembre, l’«as des as» du cinéma français s’en est allé, à 88 ans. À la fois figure du cinéma d’auteur et «action hero», Jean-Paul Belmondo en était l’un des derniers monstres sacrés.
Vous ne réussirez jamais dans ce métier avec votre physique!» Ce jugement n’a pas empêché Jean-Paul Belmondo, avec sa gouaille, de devenir le Magnifique dans le cœur des Français et un monstre sacré du cinéma. De Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965) à L’As des as (Gérard Oury, 1982), l’acteur au charisme exceptionnel a eu l’itinéraire d’un enfant gâté du cinéma, champion du box-office, avec quelque 80 films et 50 ans de carrière. À l’écran, il est tour à tour star de la Nouvelle Vague et flic ou truand dans des films grand public. Affaibli depuis le début des années 2000, il est décédé hier à l’âge de 88 ans.
Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, le jeune Belmondo grandit dans une famille d’artistes. Son père est un sculpteur reconnu. Lui aime faire le pitre et rêve de théâtre. Il intègre le conservatoire dans les années 1950 et se constitue une bande «à la vie, à la mort» avec ses copains Jean Rochefort, Claude Rich, Bruno Crémer et Jean-Pierre Marielle.
Roi de la cascade
Après des petits rôles au théâtre et au cinéma, il fait la rencontre qui scelle son destin, en la personne de Jean-Luc Godard. «C’est lui qui m’a fait aimer le cinéma (…) Avant À bout de souffle, on m’avait tellement dit que je n’étais pas bon que je doutais», confiait en 2001 Jean-Paul Belmondo. Ce premier rôle clef, en 1960, aux côtés de Jean Seberg, le propulse sur le devant de la scène. Lui au départ si réticent vis-à-vis du 7e art devient vite une vedette. Et, avec Alain Delon, l’un des deux monstres sacrés du cinéma français.
Mélange de titi parisien à la Gabin – le héros de Quai des brumes l’adoube d’ailleurs sur le tournage d’Un singe en hiver (Henri Verneuil, 1962), avec la réplique : «Môme, t’es mes 20 ans!» –, de pitre à la Fernandel et de jeune premier à la Gérard Philipe, il enchaîne les succès. Acteur emblématique de la Nouvelle Vague, il se tourne vite vers les comédies et les aventures rocambolesques où il enlace les plus belles actrices, de Catherine Deneuve à Sophia Loren en passant par Claudia Cardinale et Françoise Dorléac. Certaines deviennent ses compagnes à la ville, comme Ursula Andress et Laura Antonelli.
Passionné de boxe – gamin, il rêve d’égaler Marcel Cerdan –, il privilégie ensuite les rôles très physiques avec moult cascades sans doublure, et coups de poing. C’est la période des superflics, des machos bagarreurs et des truands : Borsalino (Jacques Deray, 1970), où il se retrouve face à son ami et rival Alain Delon, mais aussi Le Magnifique (Philippe De Broca, 1973), Flic ou voyou (Georges Lautner, 1979) ou encore Le Professionnel (Georges Lautner, 1981).
«On a fini par me coller une étiquette» de cascadeur alors que «moi, ce que j’ai eu envie de faire, dans ma carrière, c’est de naviguer entre Malle, Godard, Melville et des gens comme Verneuil, Deray, Lautner», confiait-t-il. Et «si je n’exécute pas de pirouette, on m’en veut, on m’étrille», plaisantait-il en 2016 dans un livre de souvenirs. Comme dans le très beau La Sirène du Mississipi (François Truffaut, 1969) où il est un amoureux transi.
Du «polar de trop» aux magazines people
Pendant plus de vingt ans, 48 de ses films dépassent chacun le million d’entrées… Jusqu’au Solitaire (Jacques Deray, 1987), son premier gros échec commercial. «Le polar de trop. J’en avais marre et le public aussi.» Il rebondit avec le personnage truculent de Sam Lion dans Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch (1988). L’un de ses plus grands rôles, avec à la clef le César du meilleur acteur, trophée qu’il ne va pas chercher. Il revient à ses premières amours : il remonte sur les planches avec Kean et Cyrano et devient propriétaire du Théâtre des Variétés.
Mais à partir de 2001, un accident vasculaire cérébral qui l’a fortement handicapé l’écarte des studios. Hormis un bref retour dans Un homme et son chien (Francis Huster, 2008). L’histoire d’un vieillard que la société rejette, pâle copie du chef-d’œuvre néoréaliste Umberto D. (Vittorio De Sica, 1952) à la gloire d’un acteur que son état de santé a désormais rendu méconnaissable et incapable de s’exprimer.
Le visage buriné et éternellement bronzé, «Bébel» alimente alors davantage la rubrique people. Après son divorce avec Natty, il défraie la chronique avec sa nouvelle conquête, une sulfureuse ex-mannequin belge, dont il se sépare en 2012. Récompensé d’une Palme d’honneur à Cannes en 2011, d’un Lion d’or à Venise en 2016, il est à l’honneur des César 2017 où il est longuement ovationné. Canne à la main, «Bébel» ravit une nouvelle fois le public en plaisantant sur sa «sale gueule», qui va beaucoup manquer. On peut toujours compter sur Netflix, qui propose une quinzaine de ses films les plus célèbres, de Léon Morin, prêtre (Jean-Pierre Melville, 1961) à Hold-Up (Alexandre Arcady, 1985), en passant par Godard, Lautner, Deray, De Broca…
Je ne pense jamais à mon passé. Devant, devant, devant
Flic et voyou, mais pas que…
Belmondo en huit rôles
À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)
«Si vous n’aimez pas la mer, si nous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… Allez vous faire foutre!» La réplique, déclamée face caméra et à l’attention du spectateur, fait mouche. Parce qu’avec ce nouveau cinéma qui inventait ses propres règles, Jean-Luc Godard faisait naître la Nouvelle Vague. Premier film, premier acteur fétiche : dans le rôle de Michel Poiccard, Belmondo y est déjà un voyou désinvolte, préfigurant bien d’autres incarnations à venir. Monumental.
Le Doulos (Jean-Pierre Melville, 1962)
Alain Delon, révélé la même année que Belmondo, deviendra un nom inséparable de celui de Jean-Pierre Melville. Mais au début des années 1960, le cinéaste tourne trois films avec Belmondo, dont celui-ci, matrice de ses polars plus tardifs. L’acteur y est le «doulos» (l’indicateur de la police) du titre, qu’il interprète sèchement, en contrepoint au style sophistiqué de Melville, jusqu’à un final nihiliste qui creuse et amplifie celui d’À bout de souffle.
Le Voleur (Louis Malle, 1967)
Encore un voyou, bien différent celui-là, qui «devient voleur d’abord par dépit puis (qui) le reste par plaisir», selon Belmondo. Affublé d’une moustache qui sied si bien à l’époque du film (la fin du XIXe siècle), l’avatar d’Arsène Lupin que joue l’acteur retrace sa dure vie de gentleman cambrioleur. Il y a certes une bonne dose d’aventure, mais Belmondo brille surtout par son effronterie flamboyante dans un grand film sous-estimé qui fiche une grande claque à la bourgeoisie.
Le Magnifique (Philippe De Broca, 1973)
La collaboration entre Philippe De Broca et Jean-Paul Belmondo a donné quelques-unes des plus belles réussites du cinéma populaire français, et Le Magnifique est à la fois l’un des plus marquants et le plus curieux. Vrai film libre, avec deux Belmondo pour le prix d’un – il y est François Merlin, écrivain de seconde zone, et Bob Saint-Clar, espion et héros des romans du précédent –, l’acteur livre un vrai festival où tous les excès sont permis, dans l’exotisme, l’humour, l’action… et même le gore.
Stavisky (Alain Resnais, 1974)
Après Stavisky, Belmondo ne retournera plus au cinéma d’auteur, ou alors tardivement, lui préférant le grand spectacle. C’est que l’acteur, qui fut aussi l’un des producteurs du film, a été profondément marqué par le mauvais accueil du film à Cannes. Pourtant, dans la peau de l’escroc et aventurier Serge Alexandre Stavisky, il compose un portrait psychologique formidable, mis en scène avec finesse par Alain Resnais.
Peur sur la ville (Henri Verneuil, 1975)
On retient moins volontiers que Peur sur la ville fut l’unique incursion française dans le genre profondément italien du «giallo». Et pour cause : c’est surtout le film où Belmondo devient définitivement «Bébel». À plus de 40 ans, il se livre à des cascades impressionnantes, sur un pont ou les toits de Paris. Et il s’agit clairement de la meilleure raison de voir le film.
Le Professionnel (Georges Lautner, 1981)
Joss Beaumont, c’est «Bébel» en définitive, qui passe du bon côté de la loi à l’ennemi public numéro 1, empruntant au passage un comportement brillant d’arrogance. Un face-à-face immense avec Robert Hossein en flic fasciste et une mort lâche et injuste : oui, Le Professionnel est probablement le plus grand rôle populaire de Belmondo, exubérant et sublime, achevant la légende qu’il avait bâtie jusque-là.
Peut-être (Cédric Klapisch, 1999)
La fin de carrière de Jean-Paul Belmondo est tout sauf fameuse, servant la soupe à une star sans rien avoir de consistant à lui proposer. Sauf Cédric Klapisch, qui, avec Peut-être, livre une vraie bizarrerie : un film de science-fiction dans lequel Romain Duris est projeté en 2070, dans un Paris enseveli sous le sable, où il fait la rencontre de son petit-fils, Belmondo. Une étrange fable pour un vrai au revoir au cinéma, deux ans avant l’AVC qui mettra fin sa carrière.
Valentin Maniglia
Valentin Maniglia
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois