Que sa plume signe de son vrai nom ou du pseudo de son double littéraire, l’écrivain Paul Couturiau est un remarquable alchimiste de la fiction et du réel. Découverte de ce formidable conteur, à la faveur de deux chroniques de ses romans.
« Ce feu qui me dévore » (2018, éd. Presses de la Cité, collection Terres de France)
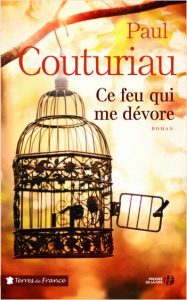 A quel âge décide-t-on de devenir écrivain ? Dès l’enfance, selon Paul Couturiau. C’est du moins ce qu’il fait dire à Bernard Bertin, personnage central et parfait avatar de l’auteur de Ce feu qui me dévore. La teneur autobiographique de l’ouvrage relève de l’évidence. Le jeune bruxellois passe le plus clair de ses vacances scolaires au Sablon, auprès de son grand-père, le pépère, figure tutélaire auquel le lie un amour indéfectible que celui-ci lui rend bien. C’est dans son jardin que Paul-Bernard a investi une maisonnette, son refuge et sa tour d’ivoire. « C’était là que je trouvais les respirations nécessaires à ma survie. Là que j’assouvissais ma soif d’écriture ».
A quel âge décide-t-on de devenir écrivain ? Dès l’enfance, selon Paul Couturiau. C’est du moins ce qu’il fait dire à Bernard Bertin, personnage central et parfait avatar de l’auteur de Ce feu qui me dévore. La teneur autobiographique de l’ouvrage relève de l’évidence. Le jeune bruxellois passe le plus clair de ses vacances scolaires au Sablon, auprès de son grand-père, le pépère, figure tutélaire auquel le lie un amour indéfectible que celui-ci lui rend bien. C’est dans son jardin que Paul-Bernard a investi une maisonnette, son refuge et sa tour d’ivoire. « C’était là que je trouvais les respirations nécessaires à ma survie. Là que j’assouvissais ma soif d’écriture ».
Mais à quoi l’enfant devait-il survivre, au juste ? Bernard Bertin révèle au lecteur, par le truchement du « roman » qu’il rédige, l’indicible vérité des sévices que son père lui inflige au quotidien et dont la mère est l’instigatrice. Voici le lecteur plongé dans l’insoutenable description de scènes d’une violence extrême ; c’est alors le thème de la maltraitance qui occupe la première place du roman et auquel Paul Couturiau consacre un réquisitoire implacable. Il est vrai qu’il connaît son sujet pour l’avoir vécu dans sa chair et le lecteur comprend que les stigmates ne se sont pas effacées lorsque Paul adulte fait le choix, des décennies plus tard, d’en faire le sujet de son roman. Si le titre joue sur la dualité du sens accordé au mot « feu », puisque la trame romanesque repose sur l’incendie criminel qui coûta la vie à la mère et blessa grièvement le père et que ce cadre fictionnel alimente l’enquête qui devra déterminer si Bernard Bertin est l’assassin de ses parents, il n’en reste pas moins que ce feu dévore encore l’auteur au point que ce n’est qu’en « tuant le père » de manière fantasmée qu’il exorcisera ses blessures.
Cette schizophrénie qui nourrit l’imaginaire de tout écrivain, nous la trouvons illustrée à la page 251 du livre : « Je l’admets bien volontiers, lire et écrire ont toujours été pour moi des moyens de fuir le monde réel. Combien de fois n’ai-je pas imaginé que j’avais été enlevé à mes parents à la naissance par des sortes de Thénardier nantis qui m’élevaient à la schlague. Un jour mes vrais parents me retrouveraient et m’arracheraient à mes tortionnaires, qui seraient aussitôt envoyés au bagne. »
Le lecteur ne pourra qu’adhérer au subtil alliage de la fiction et du réel dont Paul Couturiau est le remarquable alchimiste et qui constitue sa marque de fabrique.
Gérard Noll
« La ville éphémère » (2012, Presses de la Cité, collection Terres de France)
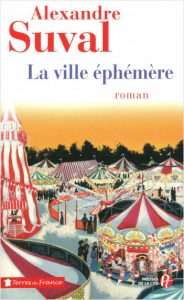 Dans ses remerciements, l’auteur cite Alexandre Dumas, Eugène Sue et Paul Feval, trois grands noms du roman populaire du XIXe siècle, « créateurs de ces rêves qui ont permis à un enfant triste de s’évader dans un monde imaginaire où il a puisé la force de continuer à vivre ».
Dans ses remerciements, l’auteur cite Alexandre Dumas, Eugène Sue et Paul Feval, trois grands noms du roman populaire du XIXe siècle, « créateurs de ces rêves qui ont permis à un enfant triste de s’évader dans un monde imaginaire où il a puisé la force de continuer à vivre ».
Sachant que de l’amalgame de ces trois noms résulte le pseudonyme choisi par Paul Couturiau – Alexandre Suval – pour signer La ville éphémère, on renverra le lecteur désireux de découvrir les raisons de la tristesse de l’enfant au dernier opus publié par l’auteur, sous son nom cette fois, Ce feu qui me dévore.
Quant à La ville éphémère, c’est un retour à la fiction pure autour d’une manifestation marquante de la deuxième moitié du XIXe siècle, époque de prédilection de l’auteur. Celui-ci ressuscite en effet la fameuse foire de Neuilly, très prisée des Parisiens, à une demi-lieue de la capitale. A peine la barrière de Neuilly franchie, c’est un univers interlope qui happe les bourgeois des beaux quartiers venus s’encanailler pour un soir. Les « banquistes » (forains), lutteurs, bonimenteurs ou diseuses de bonne aventure rivalisent d’artifices pour capter l’attention des « branques » (le public) et les attirer tels des papillons de nuit vers leurs lumineuses baraques. La minutieuse (car très documentée) description du champ de foire que nous offre l’auteur au chapitre 5 du roman est extraordinairement vivante et colorée. Nous voici d’emblée plongés dans cette atmosphère étrange et fascinante, bien disposés à entrer dans les méandres d’une intrigue palpitante.
Le vicomte, qui est un peu le prince des forains, est séduit par la belle Eloïse et se propose de la rejoindre pour un rendez-vous galant qui s’annonce très prometteur. Mais l’un et l’autre tombent dans un terrible guet-apens et ils succombent sous les coups d’assassins à la solde d’un maître sanguinaire.
Cinq ans ont passé. La foire de Neuilly est de retour. Les banquistes n’ont rien oublié de la scène d’horreur dont ils avaient été les témoins impuissants. Et la vengeance s’organise ; elle se soldera par la traque impitoyable des assassins qui seront débusqués et châtiés jusqu’au dernier avec la même sauvagerie que celle qu’eux-mêmes avaient employée.
Le « clou du spectacle », pour faire référence à une attraction évoquée dans le roman, est que la scène de ce crime commis cinq ans auparavant a été reconstituée, au cœur de la foire, dans un musée vivant qu’ une main anonyme et mystérieuse met à jour au fur et à mesure de l’accomplissement de la vengeance.
Paul Couturiau, alias Alexandre Suval, se montre brillant dans l’évocation d’une fête d’une autre époque, moyennant un important travail de recherche dont témoigne la riche bibliographie citée dans les remerciements. Il met également en œuvre un talent déjà largement mis en évidence dans ses précédents ouvrages, celui d’un remarquable conteur, habile à tenir son lecteur en haleine. A l’instar des trois maîtres auxquels il rend hommage par le choix de son pseudonyme.
Gérard Noll
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois



