Le lauréat du prix Pulitzer de la fiction 2020 est arrivé mercredi chez les libraires dans sa traduction française. Nickel Boys raconte l'histoire – vraie – d'un jeune garçon noir enfermé par erreur dans un centre de redressement et qui va y découvrir une réalité sinistre.
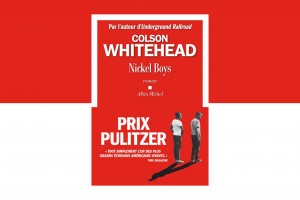 Pendant des années – son premier livre, L'Intuitionniste, a été publié en 1999 – les thèmes de la question raciale et la ségrégation ont été abordés naturellement par le romancier Colson Whitehead, sans jamais être, toutefois, le sujet principal de ses œuvres. Né en 1969, l'écrivain new-yorkais a grandi dans les années 1980 de l'épidémie de crack qui a ravagé le pays et, en particulier, sa ville, puis, jeune adulte, a vécu l'affaire Rodney King (la même année où il est sorti diplômé de l'université d'Harvard, la plus prestigieuse, mais presque exclusivement blanche, des États-Unis).
En 2016, son roman historique Underground Railroad, qui retrace le destin d'une jeune esclave qui s'enfuit de sa plantation de coton en empruntant le chemin de fer clandestin mis en place à la moitié du XIXe siècle, marque la première fois où Whitehead, dont les personnages fictifs évoluent dans une très fidèle réalité historique, se confronte aux tabous de l'esclavage.
Écrit sur une longue période de 16 ans – ce qui remonte donc aux débuts de sa carrière – Underground Railroad est auréolé, en 2017, du prix Pulitzer de la fiction. Cette même récompense, Colson Whitehead l'obtient une seconde fois ...
Pendant des années – son premier livre, L'Intuitionniste, a été publié en 1999 – les thèmes de la question raciale et la ségrégation ont été abordés naturellement par le romancier Colson Whitehead, sans jamais être, toutefois, le sujet principal de ses œuvres. Né en 1969, l'écrivain new-yorkais a grandi dans les années 1980 de l'épidémie de crack qui a ravagé le pays et, en particulier, sa ville, puis, jeune adulte, a vécu l'affaire Rodney King (la même année où il est sorti diplômé de l'université d'Harvard, la plus prestigieuse, mais presque exclusivement blanche, des États-Unis).
En 2016, son roman historique Underground Railroad, qui retrace le destin d'une jeune esclave qui s'enfuit de sa plantation de coton en empruntant le chemin de fer clandestin mis en place à la moitié du XIXe siècle, marque la première fois où Whitehead, dont les personnages fictifs évoluent dans une très fidèle réalité historique, se confronte aux tabous de l'esclavage.
Écrit sur une longue période de 16 ans – ce qui remonte donc aux débuts de sa carrière – Underground Railroad est auréolé, en 2017, du prix Pulitzer de la fiction. Cette même récompense, Colson Whitehead l'obtient une seconde fois ...Cet article est réservé aux abonnés.
Pour profiter pleinement de l’ensemble des articles, découvrez nos offres d’abonnement.
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois




