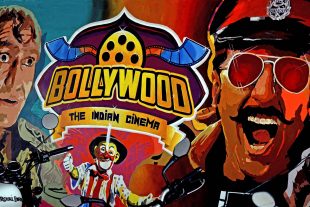Invitées par le «Kufa’s Urban Art» à peindre sur les murs d’Esch-sur-Alzette, l’Autrichienne Frau Isa et l’Équatorienne Vera Primavera témoignent de ce que c’est d’être une femme dans le street art et donnent leur vision de la discipline.
Durant cinq jours, à un rythme souvent effréné, toutes deux se sont approprié un mur, à l’école du Brill et son annexe. Entre les enfants enthousiastes et la météo changeante, elles racontent leur passion… au féminin. Frau Isa et Vera Primavera sont dans le street art depuis une dizaine d’années.

Frau Isa. (photo Mantra)
Comment êtes-vous devenues street artistes ?
Frau Isa : J’ai toujours aimé dessiner et c’est vers mes 16 ans que j’ai commencé à le faire sur les murs, dans ma petite ville du sud de l’Autriche. Rien de très excitant, non ? (Elle rit) .
Vera Primavera : J’étais étudiante et, chaque soir, quand je rentrais chez moi, je passais dans cette rue, sans lumière, inquiétante. Un coupe-gorge typique et flippant. Puis un jour, sur un des murs le plus imposant, quelqu’un a posé un graffiti. Du jour au lendemain, je me suis sentie accompagnée, en sécurité. Je me suis dit : « Une personne a le courage de venir ici, la nuit, et de réaliser une œuvre. » Pourquoi pas moi, alors ? À partir de là, c’est devenu une obsession.
F. I. : Ça, c’est une histoire !
Pouvez-vous donner votre définition personnelle du street art ?
F. I. : (Elle souffle) C’est compliqué… Pour moi, ça englobe tout ce qui touche de près la ville, ses rues, ses coins… Une sorte de témoignage urbain, au même titre qu’un jongleur devant un magasin ou une installation. Ça peut être permanent, comme éphémère. C’est juste l’émanation d’une action au cœur de la cité. Un art ouvert, visible de tous.
V. P. : La même chose (Elle rit) . Disons également que le terme « street art » est un fourre-tout, en particulier aujourd’hui. Tout le monde se l’approprie, car c’est à la mode et ça se vend bien. Moi, je fais du graffiti !
Est-ce compliqué d’être une femme dans un milieu majoritairement masculin ?
F. I. : Mais c’est compliqué d’être une femme dans n’importe quel milieu, la société restant essentiellement phallocrate. Il faut donc être à fond, et prouver ce que l’on sait faire, en permanence, et sûrement plus qu’un homme. C’est ce que je m’applique à faire depuis 15 ans… Après, je ne parle même pas des conditions de travail, physiques, et des endroits sales, insalubres, où l’on évolue (…) C’est dur. Je fais aussi partie d’un collectif (NDLR : The Weird) dans lequel je suis la seule femme. Ce n’est pas tout le temps évident, surtout quand on passe aux toilettes après eux… Mais je préfère leur compagnie à celle des filles. C’est plus direct, moins complexe.
V. P. : Je suis d’accord sur ce côté pointilleux et acharné qu’il faut mettre dans notre travail et, comme Isa, je m’accommode bien de la présence masculine. De toute façon, ça fait des années que je traîne et m’amuse avec eux. Par contre, il y a deux ans, j’ai été à un festival « 100% féminin » à Quito (NDLR : capitale de l’Équateur). C’était cool, détendu. Chacune apprécie le travail des autres, ce qui, chez les hommes, est moins évident. La compétition et l’égocentrisme restent malheureusement toujours très présents.

Vera Primavera. (photo Mantra)
Dans votre pays, est-il difficile de développer son art, légalement ou illégalement ?
V. P. : Pendant longtemps, ça a été très facile. On sonnait à une porte, on demandait : « Y a-t-il moyen de peindre sur votre mur ? » et, dans la majorité des cas, l’habitant était d’accord. En Équateur, ainsi, certaines villes sont recouvertes de graffitis. Mais les choses ont changé, à cause d’une politique de droite plus rigoureuse. Aujourd’hui, il faut une autorisation, délivrée par quelqu’un qui ne connaît absolument rien à l’art ! Et si on se fait attraper sur le fait, c’est 500 dollars d’amende, la confiscation du matériel et, pour les plus malchanceux, de la prison… Mais, à l’instar de la prohibition aux États-Unis, les interdictions conduisent à un développement – illégal – du street art. Les collectifs se développent, se concurrencent, vont de plus en plus loin dans les idées, même si, il faut le dire, la qualité en pâtit. Qu’on se le dise, on n’arrête pas le graffiti !
F. I. : En Autriche, c’est tout aussi difficile, sachant qu’à Vienne beaucoup de bâtiments à la valeur historique sont protégés. Pour mon premier grand mur, j’ai dû attendre deux années, et notamment recueillir les signatures de tous les résidents de l’immeuble… Un truc de fou ! Et après ça, il faut être ultratransparent, détailler son projet, rester lisse… Bon, il faut reconnaître que les choses vont mieux depuis le passage de quelques festivals dédiés au street art. Les esprits se libèrent. Après, dans la campagne, il faut juste demander à l’agriculteur s’il est d’accord !
Que pensez-vous du « Kufa’s Urban Art » ?
F. I. : Pour une petite ville comme Esch-sur-Alzette, c’est juste incroyable. La Kulturfabrik fait un excellent boulot et je pense que la population lui en est reconnaissante. Dommage que certains politiciens glissent leur nez dans cette affaire, car pour un artiste, être brimé ou orienté, ce n’est jamais bon… Ils devraient rester à leur place et ne pas débarquer en disant : « Ça, c’est bien, ça, non… » Ils n’imaginent pas tout l’investissement qu’il y a derrière.
V. P. : C’est toujours le même problème : les politiques ne comprennent rien à l’art, mais ils ont l’argent et on doit, parfois, faire le dos rond. L’année dernière, j’ai organisé un festival dans ma ville qui, comme elle a mis la main à la poche, voulait son logo en haut de chaque mur… Incroyable ! On a dû s’y résigner, parce que sinon on nous coupait les subventions. Mais lors de la prochaine manifestation, ce coup-ci, on va se protéger contractuellement.
F. I. : Bonne chance avec ça !
Votre expérience à Esch a-t-elle été agréable ?
F. I. : Cette semaine, le temps n’était pas terrible, entre pluie et grosses chaleurs. On ne s’est pas ennuyées ! Mais travailler dehors réclame un effort d’adaptation. Et il y a tous ces enfants, passionnés par ce que l’on fait. Ils sont là, à vous regarder travailler, à vous faire des signes, sûrement plus enthousiasmés, d’ailleurs, par le monte-charge que j’utilise que par mon travail (Elle rit) .
V. P. : Les enfants sont mes favoris. Il y a deux jours, il y en a un qui m’a apporté un gâteau, puis un parapluie, avant de me demander : « Je peux monter tout en haut avec vous ? » Malin, avec ça…
F. I. : Avec eux, il y a la transmission qui entre en ligne de compte. Je ne sais pas, mais peut-être qu’en nous voyant peindre, ils se disent qu’il y a plein de moyens différents pour s’en sortir dans la vie.
V. P. : Ça leur change, en tout cas, des travaux publics ! Voir quelqu’un peindre en pleine rue, oui, ça peut faire naître des vocations. Et désolée, mais dans ce sens, ce sont les filles qui sont les plus enthousiastes !
Entretien avec Grégory Cimatti
 Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois
Le Quotidien Indépendant Luxembourgeois